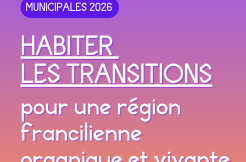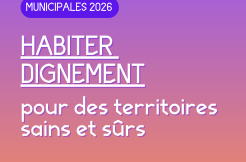Le logement n’est pas une promesse : c’est une responsabilité collective
13 oct 2025Édito
Alors que la France se trouve toujours dans l’impasse gouvernementale et au pied du mur des débats budgétaires, la crise du logement continue de toucher de plein fouet notre pays et ses habitants, notamment les plus modestes. Face à cette situation, la présidente Laurence Bertaud a souhaité donner la parole à Houda Bendib, vice-présidente et référente de la délégation « Société » pour évoquer notre responsabilité collective autour de cet enjeu du logement, de l’apport fondamental de l’architecture pour redonner espoir et des solutions à apporter.
Le logement n’est pas seulement un enjeu social : c’est un sujet structurel, transversal, systémique. Il évoque à la fois le foncier, la fiscalité, la santé publique, l’énergie, la mobilité, l’économie circulaire, les politiques sociales et l’urbanisme réglementaire. À ce titre, il ne peut plus être traité sous le prisme de la promesse. Il doit l’être par la méthode, la cohérence et la responsabilité.
En Île-de-France, la crise du logement n’est pas seulement une question de production, mais de gestion stratégique du parc existant. Les chiffres sont connus : des dizaines de milliers de logements vacants, dont une part pourrait être mobilisée immédiatement grâce à des baux à réhabilitation, des conventions d’occupation ou des organismes fonciers solidaires. Près de cent mille situations d’habitat indigne sont recensées par les services publics — encore trop peu traitées faute de coordination entre les acteurs et de moyens réellement concentrés sur la mise en conformité. À cela s’ajoutent des passoires thermiques qui alourdissent la facture des ménages, tandis que leur rénovation reste freinée par la complexité des dispositifs et l’absence d’un accompagnement technique structuré. Quant à certaines opérations neuves, elles reproduisent parfois des logiques de standardisation, de densification mal négociée ou de temporalité trop courte.
Nous n’avons pas un problème de dispositifs : nous avons un problème d’articulation. Le véritable levier n’est plus dans la multiplication des programmes, mais dans la hiérarchisation de nos priorités. Agir sur l’existant doit redevenir la stratégie centrale. Il ne s’agit pas d’opposer construction et réhabilitation, mais de mettre l’effort là où l’impact territorial, social et énergétique est le plus fort. Mobiliser le parc vacant, résorber l’habitat indigne, structurer une ingénierie de rénovation ambitieuse, intégrer la modularité et l’usage dans chaque projet — voilà les axes d’une politique réellement durable.
L’architecture, dans ce cadre, n’est pas un supplément esthétique. Elle est un outil d’efficacité publique. Par elle, on identifie les potentiels de réversibilité d’usage, on rationalise les matériaux par le réemploi, on réduit l’empreinte carbone par la sobriété constructive. L’architecture permet d’intégrer plus finement les contraintes réglementaires et de transformer un bâtiment simplement conforme en un bâtiment habitable, confortable, transmissible. C’est dans cette approche intégrée que se joue la durabilité réelle des territoires.
Le courage politique, aujourd’hui, ne réside plus dans l’annonce d’une nouvelle loi ou d’une énième stratégie. Il réside dans la continuité, dans la capacité à organiser, à piloter, à assumer une ligne d’action claire : mobiliser l’existant, traiter l’indigne, structurer l’ingénierie, anticiper la durée de vie des bâtiments. Ce ne sont pas des slogans, mais des méthodes concrètes, observables, évaluables. Elles ne dépendent pas uniquement des moyens financiers, mais avant tout de la volonté de coordonner et de durer.
Le droit d’habiter ne sera pas garanti par la promesse. Il le sera par la décision, la cohérence et la persévérance collective.
 Houda Bendib, vice-présidente de l'Ordre des architectes d'Île-de-France.
Houda Bendib, vice-présidente de l'Ordre des architectes d'Île-de-France.
Sur le même sujet
Actualités
17 fév 2026
3 questions à
29 jan 2026
Actualités
22 jan 2026
3 questions à
19 déc 2025
Actualités
17 déc 2025